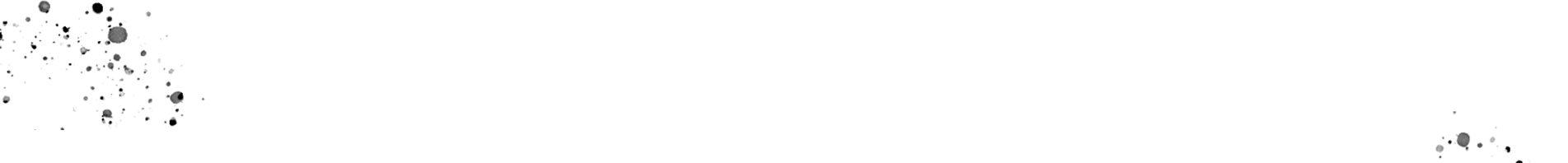Créations
personnelles
pour les curieux :
Recueil de poèmes « Les larmes de l’homme » copyright Virginie Guillou

L’homme qui fuit

La voix
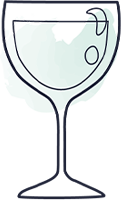
La dépendance

Insomnie

Le justicier

un dernier mot

la liane

Icône le peintre

La fée du plateau

le fou

l’ogre et l’agneau
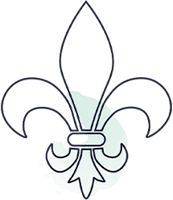
le lys
Les contes du dodo : une série de contes à raconter à votre enfant pour
l’aider à dormir et grandir : « Le prince-je-sais-pas »
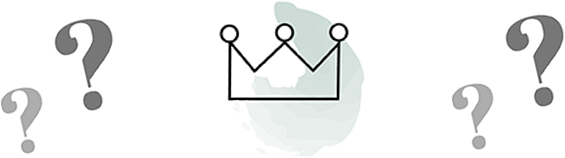
Le prince je-sais-pas
L’homme qui fuit
C’était un soir de novembre.
L’homme écouta mutique son lourd sanglot.
Pourquoi ce tremblement de terre ?
La femme avait certes du caractère,
Surement aussi quelques défauts
Et dans sa tête un maelström de maux.
Absence, solitude, colère,
Cette assiette vide, ce verre, ce couver ;
Tant de soirées d’une béance austère.
Ulysse la délaissait pour ses affaires
Plus importantes que leur amour, sa carrière.
Pour cela donc, cette chimère ?
L’homme regarda ses pieds et ne dit mot.
Pour lui, elle remuerait ciel et terre,
Elle serait douce comme un agneau.
Il était tout, son mari, son amant, son frère.
Sans lui, elle serait ce point qui coule au fond de l’eau,
Les restes déchiquetés, inutiles d’un radeau.
Alors, quand le crépuscule annonça décembre,
Les yeux enivrés d’un nouvel avenir,
L’homme inspira fort, se leva, se mit à fuir.
La femme resta là un long moment,
Observant l’homme se fondre dans l’horizon.
Elle disparut sous les premiers flocons,
Le cœur brisé, meurtri, sans explication.
L’homme, comment lui en vouloir ?
Il venait d’une lignée de fuyards
Qui s’en remettaient au hasard
Et portaient le poids de leur ombre.
Le père de l’homme avant lui,
Un autre soir d’hiver avait fui
Pour boire ses démons sombres
Et les plonger dans l’oubli.
Cet homme-là haïssait sa vie.
Comment aimer quand on a toujours menti ?
Alors, laissant derrière lui tous les paquets cadeaux,
La dinde et les marrons chauds dans le fourneau,
Il ouvrit grand la porte et partit.
Le père du père de l’homme avant lui avait fui.
Il s’était trouvé un beau parti,
Enterrant la lâcheté d’un étrange maquis ;
Cette cachette honteuse qui pourtant vous poursuit
Et avec l’argent des autres avait réussi.
Amusant comme une légende s’écrit,
Sur du vent bien souvent, avec l’art du déni.
Avec le temps on l’appela papy.
Il avait de l’argent, des maisons,
Une femme dans chaque port,
De l’alcool, des bateaux, des amis :
L’exemple cité en toute occasion,
L’enfant qu’a eu de la chance, l’enfant du pays.
Sa lignée serait pour des siècles à l’abri,
Préservée contre l’infortune et tous les coups du sort.
Certains matins tout en scrutant l’aurore,
le père de l’homme et le père de celui-ci
déchiraient le silence et lui criaient bien fort :
Remonte-le vite ce poisson, il est ferré, il mord.
Puis ils se racontaient des histoires,
Des histoires d’hommes qui fuient
Sans passé ni fardeaux, sans attache ni ennui.
Il y avait ce pacte qui les lie.
Des discussions de riens peuplées de non-dits.
Parler, ça sert à quoi ?
Cela nous éloignerait lui et toi, toi de moi.
L’homme précipitait ses pieds vers un champ de possibles
De l’autre côté d’une vallée où s’invente l’indicible.
Une autre femme pleurnichait parfois sur son épaule.
Reste ici à jamais, elle lui serinait .
Cette histoire est bien drôle
Car pour celui qui fuit, rester est une chose impossible.
Mais elle ferait l’affaire, tout au moins, pour un temps.
Elle avait une carrière, une maison, de l’argent,
Des enfants d’un premier lit
qui fleurissaient déjà vers leur autonomie.
Elle s’en remettrait très vite
Quand il lancerait tout de go qu’il poursuivait sa fuite.
La fuite était dans ses gènes
D’aussi loin qu’il s’en souvienne,
Si bien qu’il ne savait plus pourquoi il fuyait.
La nuit, quand la pleine lune de sa pâleur brillait,
Il repensait à sa vie d’avant,
Ses amis, son bonheur passé, ses enfants.
Finalement, finalement, était-il si malheureux
Pour déserter ainsi, mettre des kilomètres entre lui et eux ?
Et là, parce que la conscience parfois affleure, il se mettait à pleurer.
Des jours, des mois, des saisons passèrent.
Qu’avait-il accompli ? Il n’était pas si fier.
Sa fuite l’avait mené aux quatre coins du monde
Et toujours le même constat, la terre était bien ronde.
L’herbe si verte ailleurs, n’avait plus cette saveur,
Ses reflets chatoyants délavés, plus de couleur.
L’homme avait vieilli, il se sentait très seul
Dans sa maison aux murs blancs comme des linceuls.
Un matin de septembre, après une vision, un songe,
L’homme courut à perdre haleine pour visiter deux tombes ;
Celle de son père et du père de celui-ci.
Elles pourrissaient d’une langueur venue des catacombes.
L’écho d’une claque surgit alors de leurs mensonges.
Le soleil cognait très haut dans le ciel infini.
Un éclair l’accabla, l’homme avait enfin compris.
Ce n’était pas l’infortune, l’usure ou l’ennui,
C’était beaucoup plus simple, c’était eux, c’était lui.
Il avait passé sa vie à courir après leurs ombres,
A reproduire sans cesse leur lâcheté, leurs décombres.
Il revoyait une scène tapie dans sa mémoire
Quand son père l’abandonnait, pas même un au-revoir.
Avant qu’il ne croupisse sous terre,
Tuer son fantôme, il n’avait su le faire ;
Ni vomir sa rancœur, sa colère, son désespoir.
Ironie, son père avait vécu la même histoire :
Vouloir à tout prix se faire aimer d’un père.
Alors, il jeta sur leur stèle
Sa tristesse, son crachat, son fiel.
Sa conscience n’ayant plus besoin de se terrer,
Sur son poing se posa et l’aida à frapper.
Tout ce temps perdu à chercher cette vérité.
Elle était sous ses yeux, ne demandant qu’à vibrer :
Des ancêtres misérables, égoïstes, entêtés.
De rage, il écrasa les chrysanthèmes,
Proféra en lui de prodigieux blasphèmes.
Il aurait voulu posséder ce don magique
De revenir en arrière, effacer sa fuite tragique.
Il repensa à la femme, à ses sanglots, à son silence à lui.
Elle était la source qui jamais ne tarit ,
La lumière qui guidait ses pas dans la nuit.
Plein de remords, de nostalgie, de regrets,
A rebours, il suivit un chemin qui se désensablait.
L’homme frappa à la porte de la femme.
Dans le dernier berceau, plus de nourrisson, une jeune-fille
Qui le dévisageait sans comprendre qui c’était
Car dans la maison de la femme se trouvait un autre homme.
Elle l’appelait papa, il l’appelait sa môme.
L’homme balbutia une excuse, pardon de déranger,
Il arrivait si tard…il désirait parler.
La femme s’approcha, le scruta un instant.
Elle avait espéré tant d’hivers tant d’étés
Que son visage, sa voix, son nom, les avait oubliés.
C’était de l’histoire ancienne.
Elle le remercia en posant sa main sur la sienne.
Grâce à sa fuite, elle avait changé,
Elle était heureuse, légère, libérée.
Et refermant sa porte, lui lança un dernier baiser.
C’était un soir de novembre.
La pluie murmurait son doux clapotis.
L’homme resta là à attendre,
Son manteau tout mouillé, sous lui les pavés gris.
Sa conscience sur son bras, il ne lui restait plus ça.
Regarde un peu, chuchota-t-elle, tout cela, quel gâchis !
Des maisons, des bateaux mais tellement d’ennui.
Tu as perdu ton âme-sœur, ta seule et véritable amie,
Voilà ce qui arrive à un homme qui fuit.
La voix
L’entendez-vous cette voix qui surgit de la nuit ?
Peu avant, pourtant, elle n’existait pas encore.
La voilà qui s’invite, sortant de sa cage,
Fulgurante elle s’évade, bientôt vous poursuit
Parmi les joncs, la boue humide, les feuillages ;
Elle se dresse, terrasse votre âme, votre corps
Tout entièrement dévoués à sa pure magie.
A quoi bon vous enfuir, déserter ou lutter ?
De vous, elle connaît tout, le terrible secret,
Vos miroirs, vos désirs, vos envies , vos trésors
Au-delà des images, mieux que vous encore.
Ses dix doigts caressent maintenant vos cheveux,
Ils glissent lentement sur vos cils, sur vos yeux,
susurrent habilement des mots nouveaux, jolis,
refrain de vapeur, d’extase, éther et mélodie.
Donnez-lui votre vie, votre mort, tout votre or.
Vivre cet instant précieux, l’éternité
Sublime endroit du Soi, toute réalité.
Son étreinte dissout dans un sommeil profond
La raison abimée, l’angoisse des tréfonds.
Un doux sens s’anime, perçoit une lumière,
Une scène de théâtre, un décor apparaît.
Roi, manant, fou, reine ou visionnaire,
Vous revêtez l’habit, tous les déguisements.
Vous vous abandonnez, prodigieux univers
Et le sol se dérobe infini sous vos pieds.
Vous êtes le père, la mère, Zarathoustra et l’enfant
Le dragon et le glaive, tous les enchantements.
Tour à tour magicien, druide, chaman ou sorcière
Ne serait-ce que pour ça, pour jouir de ce moment.
Quand l’aube blafarde s’élève au firmament,
Fiévreux et engourdi, vous ouvrez grands les yeux.
Le sortilège rompu laisse une mémoire,
Des bribes de tissus, quelques trames d’histoires ;
Replonger vite, s’approcher de l’index de Dieu
Mais le son ne résonne plus, attend un autre soir.
Éternel recommencement, la voix de l’inconscient.
La dépendance
Il la regardait avec ce même amour ;
Un amour qui fait mal, celui de l’attachement.
Ils vivaient depuis si longtemps ensemble,
Se réconfortant l’un l’autre comme de vieux amants
Que la vie a écornés mais que la vie rassemble.
Elle le regardait avec ce même amour ;
Un amour qui s’inflige, un amour qui s’oblige
Qu’on retient avec force, il est là et se fige.
Ah, comme ils s’aimaient ces deux-là !
Ils se juraient passion de vie à trépas.
Surtout quand l’orage gronde et que la nuit s’annonce,
Mêlant leurs esprits fous, espérant des réponses
Aux idées noires qui germent, grandissent et puis tremblent.
Ils s’étaient connus dans un bar, cela faisait un bail.
Il s’échinait la santé dans une usine de ferraille.
Les journées étaient longues et bien mauvaise la graille,
Une toute petite piaule au fond de l’appartement
D’une vieille irascible, vilaine et sur la paille.
Pas d’avenir radieux sous le ciel de Cornouailles.
C’est là qu’il l’avait vue, ronde et séduisante.
Prends-moi, avait-elle dit, je serai ton amante,
Tu oublieras le ciel gris, ton présent, tes tourments,
Ce demain que tu rêves mais qui s’enfuit là-bas.
Je te montrerai la joie, je serai l’ombre de tes pas.
Ensemble, ensemble, on pourra se tenir chaud
Une vie de couple heureuse, je t’en fais le serment ;
Pareil que dans les contes, nous deux, ce sera beau.
Quand on est seul et triste, plus de raisonnement,
Alors, il l’avait prise, enlacée fermement.
Comme ses baisers étaient suaves, avides, assoiffés !
Rien n’y faisait, toujours plus elle en redemandait.
Elle était sa boussole, sa béquille, sa dépendance.
Les jours passaient, ils plongeaient dans l’errance.
L’avenir semblait de moins en moins radieux,
Les ciels toujours plus noirs, des ciels mornes d’adieu.
Une fois, violemment il l’avait jetée dehors,
Fini à jamais, moi à droite, toi à bâbord.
Mais ses plaintes, sa couleur qui chatoie
L’avaient apitoyé, rongé de lourds remords.
Sorti la récupérer, elle gémissait aux abois,
L’avait lovée dans ses bras, au fond elle lui manquait déjà.
Malheureux sort pour celui que quelqu’un attend ;
Ils étaient le deux, le nous, l’un bien souvent.
Elle était cette drogue qui apaise son sang
Quand mêlée à sa peine, elle glissait lentement,
Apportant cette illusion de paix, sérénité d’un instant.
Plus rien à foutre, tous des nantis, des charognards,
Trinquons à toi, à moi, aux gouffres du hasard.
Tu es ma précieuse, mon nectar, ma boisson,
celle qui comble le vide de mes larmes à foison.
Je suis ton homme, toi ma huitième merveille
O comme tu es belle…comme je t’aime ma bouteille.
Insomnie
L’autre nuit, c’était une nuit sans une étoile.
J’avais cette douleur qui me tordait la moelle.
Impossible de dormir, subite sensation
Que la nuit sera longue, nimbée de démons.
Les funestes, ils tapaient et hurlaient dans ma tête :
« Ta vie ne vaut rien, tu es bien moins qu’une bête ! »
Ils tournaient, ricanaient, préparaient leur poison,
Enflammaient un public huant au diapason.
Devant moi la tragédie qui court dans l’arène.
Gladiateur désarmé, ô je souffre et je peine.
Rester sur mes gardes, maintenir l’attention.
Prêts à me dévorer à la moindre occasion.
Mon cœur bat à tout rompre, s’apprête à fléchir.
Hélas, je n’ai rien fait, les secondes s’étirent.
Je m’en veux si fort d’être ce rien, ce néant
parasite vide de sens, las, bras ballants.
Je pense à ces heures de gloire, il y a longtemps
La vie couvrait de lauriers mes agissements.
Mon cœur irradiait d’une lumière féconde,
Mes idées éclairaient toute nuit, vagabondes.
Rien qu’à me pencher pour mes roses recueillir.
La chance partie fleurir un autre continent,
M’a laissée désœuvrée, rejetée comme un rat.
Plus d’idées, plus d’envies, plus d’amour ou hourra.
Un temps qui dure, des jours d’ennui à mourir,
Des nuits noires telles des cauchemars de Titans.
Un brouhaha explose, scission atomique,
Défusionne chaque molécule organique.
Les vils sont en moi, je respire fort et vite.
Ils m’acculent vers cette falaise fatale :
« Allez, saute si tu veux connaître la suite,
Goûter à l’éternel, à la saveur du Graal. »
Leur sabre posé sur mes genoux accablés
Reluit dans mes pupilles d’un éclat doré.
En moi, finalement, un sursaut de génie
Disparaissez, laissez-moi en paix, je vous prie !
Là, les démons se penchent, me toisent en silence
Leurs mines s’évaporent dans une macabre danse
Le preux sommeil chevaleresque a abattu leur transe.
Adieu noirceur d’une pensée, triste insomnie,
Viens dans mon sein, ma mie d’antan, ma tempérance.
Le justicier
Il portait le nom d’une célèbre maison
Connue pour ses pierreries, ses ors et ses alliances ;
L’homonyme heureux qui donne une ascendance
Sur l’esprit d’autrui, spécifiquement ses clients.
Ceux-ci se pressaient à sa porte, des hommes assurément,
Crédules, impressionnés par son bureau très grand
Et cette enseigne dorée, le blason de la justice, oui, monsieur,
Dites-moi tout, mon oreille écoutera du mieux qu’elle peut,
Par ici les remontrances, venez pleurer dans mon giron.
Déboires, houle, tempêtes sur l’oreiller du lit conjugal ?
Amer, vous souhaitez rompre tout lien matrimonial
D’avec cette femme misérable, jalouse et vénale ?
Moi, Maître Cartier, serai l’homme de la situation,
Le fossoyeur d’une vie à deux, votre digne représentant.
Pour gagner cette affaire, je vous vends mon verbe éloquent.
Rien que la justice en mon nom ne puisse défaire.
Mais avant, par ici le tiroir-caisse, allez donc voir ma secrétaire.
Bientôt vous serez soulagé, heureux, libre comme l’air.
Je vais la détruire cette vilaine, l’achever, la ruiner sans condition
Cette diablesse qui a pris du poids, des rides, vous fait vivre l’enfer.
Déjà vous vous sentez mieux, votre chèque est signé à présent.
C’était un personnage de roman, condescendant, ventripotent
Et quand il riait d’un de ses bons mots,
surgissaient carnassières toutes ses dents,
prête à déchiqueter, mettre en pièces la plus coriace des peaux.
Son dédain pour la gent féminine lui venait de sa mère,
Une femme castratrice possédant autant d’amants que de diamants
Qu’elle exhibait sans y penser dans les allées du Parc Monceau.
Elle lui avait dit un jour qu’il ressemblerait à son père,
Un homme bien-né, émasculé, aboulique, débonnaire
Qui lui avait fait cet enfant on ne sait trop comment.
Alors, pour se venger des femmes, sans doute inconsciemment,
Il avait embrassé la cause des hommes, avait prêté serment.
Ils utiliserait le glaive, la balance, tous les artifices.
Pourvu qu’il soit celui qui gagne, pas besoin de prémisses.
Ses plaidoiries étaient âpres, venimeuses, iniques,
ses adversaires accablés partaient tous en courant.
En lui il exultait, caressait sa rancœur boulimique,
Se plaisait à croire qu’il était ce bon samaritain
Aidant le pauvre, la veuve et l’orphelin.
Dans le fond, il n’aimait que lui-même et l’argent.
Dans la ruche de son domaine, d’autres bourdons
Pareils à lui le flattaient avec leur langue de miel.
Sa prestance, ses sourires de cuistre, son complexe idéel,
Il avait tout pour connaître la gloire, les honneurs mirifiques.
Des champs immenses s’offraient comme par miracle,
semés depuis des lustres pour son propre Panthéon ;
Un Élysée d’adorateurs égocentriques,
Repus et heureux de faire partie du même cénacle,
Ce lieu fait pour les bateleurs et les arrivistes : La politique.
Un dernier mot
Je t’écris tout tremblant sur ce petit bout de papier.
Mes mains sont gelées, mes souliers cruentés.
Échapperai-je à ce carnage, cet enfer, ce bourbier,
Amoncellement de têtes, corps et sang mêlés
Qui jonchent l’horizon, les vallées, les tranchées ?
Dans ma tête des éclairs ne cessent de gronder
En pensant à toi mon amour, mon vestige, mon sentier.
L’orée de ton corps, l’ambroisie de ton calice,
Tes torrents de baisers qui affluent avec délice,
La clameur de nos râles, de nos souffles, de nos mains
Qui se cherchent encore et encore pour narguer les lendemains.
Devant notre lit de jeunes mariés cet uniforme m’attendait
Pour partir loin de toi, me battre avec fierté,
Arracher aux aveugles, aux sourds, aux enragés
Ce qui nous est si cher à toi à moi: la liberté.
C’est devant toi mon amour, mon vestige, mon sentier,
Imaginant ce jour où peut-être je reviendrai,
Que je déposerai les armes. Devant l’ennemi jamais !
Ton ventre sera rond, tu me baiseras le front,
Je repartirai à la conquête de tes plaines, de tes monts.
De nos bouches jailliront des mots que seuls nous connaissons.
Dans ma tête des éclairs ne cessent d’approcher.
J’entends des pieds qui s’affolent, des fantômes errer.
Je suis à présent mélancolique et morose
Car sur ma tempe, mon cou, ma veste trouée
s’éparpillent des éclats de rouge et de rose,
sans m’en rendre compte j’ai été touché.
Un dernier mot mon amour, mon vestige, mon sentier
Et s’il te plaît il ne faudra pas pleurer.
Quiconque ne pourrait piétiner notre histoire,
L’odeur de cette quiétude éternelle en ma mémoire,
Gravée en lettres capitales
comme l’est un idéal,
Le parfum parfait du bonheur,
Ton cœur battant contre mon cœur.
La liane
Sans chaussures, sans le sou, elle créchait au hasard.
Il lui restait ce sourire et ce port altier,
Un amas de guenilles, un carton écorné
Qui lui servait de lit, maison quand vient le soir.
Ba moin une pièce s’il vous plaît.
Elle faisait peur aux mamans
Mais les enfants l’adoraient.
Dans ses yeux irisés des éclats de printemps,
Des glouglous, des magnolias et des gommiers blancs,
des alizées, des soleils, du bois, des solstices,
Des ibiscus, des iguanes et de la mélisse.
Ses jambes de liane tanguaient aux quatre vents,
Claquaient quand elle avait froid et faim si souvent.
Elle avait troqué le tamarin, la vanille
Pour suivre un blanc taiseux détestant les Antilles.
Piégée dans une tour monochrome, que du gris,
Les gens couraient dans les rues une course inutile,
N’entendaient rien à la chaleur de ses volcans,
Critiquaient son accent, la beauté de son île.
Elle quémandait un refuge, un trou de souris
Mais que des portes interdites, des maisons closes.
Le taiseux était froid mais avait le sang chaud.
Il vivait de larcins, de trafics pour sa dose.
La liane, comme il l’appelait, devenue sa chose,
Acceptait de lui la violence, les ecchymoses.
Quand il ne lui resta que ses yeux pour pleurer,
eut perdu son soleil de joie, sa dignité,
traîna son corps aride et prit son sac à dos.
Ba moin une pièce s’il vous plaît.
Pas pour la drogue, pas pour manger ou l’alcool,
Pour rentrer chez moi, là où tous les oiseaux chantent,
Là où l’espoir se raconte si bien en créole,
Là où les corps dansent et où la tristesse s’absente,
Pour quitter le froid de vos cœurs de Métropole.
On dit qu’elle chaloupe dans un coin de métro
En compagnie d’un serf venu de Bamako,
Qu’ensemble ils écrivent des lagunes, des lagons,
Sur les murs des tunnels, sur l’entrée du carton
Où ces deux cousins du lointain se tiennent chaud.
Le peintre
Les saules pleurent d’une charmante langueur
La reinette accroupie écope la fraicheur
Une perdrix argentée découvre les couleurs
Des dahlias, des pivoines, des nénuphars en fleurs.
Le peintre se gratte la barbe, le menton,
Une ombre vient de perturber sa vision.
Mouvoir le chevalet, affûter son crayon,
Croquer cette scène, garder l’inspiration.
La brise d’automne s’accorde à l’unisson,
Caresse les pigments broyés sur le perron.
Déjà sonne la cloche, annonce une réunion
De famille rassemblée en cette saison.
L’artiste n’entend pas, se soustrait au trivial,
Car devant ses yeux cerclés de cendre, un peu vieux,
Oh, se dévoile et s’agite une bacchanale.
Les pourpres, les violets, enlacés, amoureux
Des bronzes, des ambres, des émeraudes et des bleus.
Le pinceau se trempe dans l’huile aux reflets blonds
S’étire sur la toile, lignes d’horizon,
Glisse bas et haut dans un mouvement lascif,
Dissipe le blanc, macule l’admiratif,
Choqué par le spectacle qui naît devant lui :
La beauté de la nature en rien égalable.
Les artistes ne pourraient être ses semblables,
Pas même les génies.
Pourtant, ils aspirent à en extraire l’essence,
Saisir l’intrinsèque, sublimer sa brillance,
Travail de toute une vie ;
Tenter de toucher le sacré, transmettre aux hommes
Ce qu’il y a de beau, à l’état brut en somme.
La Fée du plateau
Depuis combien de vies et de siècles déjà ?
…Depuis qu’elle s’était abandonnée, c’est bien ça.
Recluse des villes, elle vivait sur un plateau
Aussi sec, désenchanté qu’un été sans eau.
Pourtant elle avait le cœur grand comme le monde.
Ses mains curaient le tragique, agitaient la ronde
Des papillons de nuit qui colportaient leurs dons
Dans les prés gris délestés de leurs poisons.
Ses soirées étaient longues, sans réel sommeil,
Hantées par le passé de gens demandant conseil.
Ils s’allongeaient sur le divan, elle écoutait
Les contours de leur âme, les réinventait
Avec la chaleur de sa voix, sa fine oreille
Qui entend les maux, elle n’avait point de pareil.
La lune joue avec le soleil, elle écrit…
…Des millions d’histoires que personne ne dit.
Elle voit par-delà les yeux, suture des plaies
Tombées un jour dans la rivière aux sortilèges,
Cherchant depuis leur bonne étoile et leur cortège
Aux confluents du Loing sous un lit de violettes.
Telle une magicienne, elle secoue sa baguette,
Prononce des formules, crée une recette :
Les crapauds borgnes se mutent en princes charmants
Doués pour peindre des arcs-en-ciel aux enfants.
Sur son plateau, elle soulève des montagnes,
Épice d’iode, d’embrun les glabres campagnes,
Décroche la lune, fait s’abattre la pluie
Après les canicules, les solitudes de vie.
Elle n’appartenait pas à ces prés, ce plateau.
Elle venait de la grande ville, des lumières,
Des passages et des rues où les esprits s’affairent.
Alors, perdue sur son plateau, quand vient l’hiver,
A perte de vue du rien, des champs gelés de corbeaux,
Obligée de devenir un phare pour guider les bateaux
Ivres, perdus, inondés de larmes et fardeaux.
Sa vie était dédiée aux problèmes des autres,
A une famille aussi, un chien, un vélo.
Elle montrait le chemin, ils suivaient leur apôtre.
Vaillante, elle portait tout ce monde sur son dos.
Des sablés, des gâteaux, cuisaient dans son fourneau
Pour rassasier la voie de tous ceux qui frappaient
A la porte des étangs, des champs et des prés,
A la grande porte de leur fée du plateau.
Le Fou
Art, Liberté, égalité, fraternité
Ces quatre mots résonnaient dans sa tête.
Pour eux, les deux derniers, il avait sacrifié
Tout son art, son essence, sa raison d’être.
Il marchait dans les rues vides de lumière,
Un bonnet de fou accroché sur son derrière.
Les passants se moquaient et le montraient du doigt.
Les yeux mi-clos, le fou avance, ne voit pas
La violence des hommes, les tombes là-bas
Car il regarde l’ailleurs, le meilleur, le ciel.
Il gobe des couleuvres, elles fondent, deviennent miel.
Libre d’esprit, le fou n’est pas celui qu’on croit.
Son ombre dans la nuit avait perdu sa voix.
Elle glissait diaphane dans la brume du soir,
Flairant la mémoire d’un public, d’un espoir.
Il n’avait rien que son cœur dans un baluchon
Qu’il trimballait avec lui, c’était sa maison.
Dedans, des merveilles pour celui qui peut voir,
Ouvre curieux la porte plongée dans le noir,
redécouvre feues les langues du nouveau monde,
embarque sur sa nef que des torrents inondent,
passe les barrages, les chutes, les rapides,
finit son voyage sur une terre humide
où on oublie tout, la sécheresse, les malheurs.
Funambule, le fou continue de marcher.
La foule retient son souffle, attend qu’il tombe
Pour rire d’un gros éclat. Comme c’est drôle
La chute et la mort annoncée d’une colombe.
Le fou a ses yeux verts grands ouverts, il sourit.
Ce parasite serait-il toujours en vie ?
Écrasons-lui les mains, enterrons-le vivant !
Oust, dans le trou de l’oubli…qu’est-ce donc à présent
Cette chose qui scintille au-dessus lui ?
Diable, nous serons tous damnés, une auréole.
Sous le bonnet du fou se cachait le sacré
Et nous, plus fous que lui, venons de le tuer.
Libre, le fou s’avance pour l’éternité.
La large porte des anges laisse filtrer
Ce qu’il cherchait tout ce temps, son public d’antan.
Art, liberté, égalité, fraternité
Des enfants ont écrit ces mots sur un cadran.
Ils les répètent en chœur pour ne plus oublier.
L’Ogre et l’Agneau
Ma beauté, comme tu es jeune, frêle, innocente.
Prends-la donc ma main, tu peux me faire confiance.
Je suis tonton Daniel, le mari de ta tante,
Je t’ai vue grandir, je t’ai même appris la danse.
C’était tous les étés pendant les grandes vacances.
Tu mettais tes pieds sur les miens, je te guidais.
Tu riais à gorge déployée, comme tu étais contente.
Maintenant ta gorge a bien changé, l’as-tu remarqué ?
Tu n’es plus un bébé, quel âge ? Huit, neuf ans ?
Je peux te raconter un conte pour les grands.
Il était une fois un ogre pas si méchant.
Ce n’était pas de sa faute, s’il aimait croquer
De la chair bien tendre, c’était son secret.
Quand les hommes préfèrent une viande mature,
Lui n’avait d’yeux que pour les petiots, les agneaux.
Tant d’amour il percevait dans leurs yeux azur !
Comment reprocher à un ogre sa nature ?
Il jouait avec eux, leur caressait les cheveux,
Exauçait tous leurs caprices, c’était si joyeux.
Jusqu’à ce qu’il montre ses bottes de sept lieues.
Ensorcelés, figés, ils se laissaient croquer.
Les agneaux entachés de sang par sa dent dure
Retournaient silencieux chez eux, cachant leur plaie.
Personne ne disait mot, pas même cet agneau
Dont les larmes coulaient, personne ne voyait.
Et voir quoi ? L’ogre savait croquer où il faut,
Pile poil dans les plis, sous la laine, sous la peau.
L’ogre était heureux, repu mais pas pour longtemps
Son instinct lui tordait le ventre, il en redemandait.
Aimer, aimer, aimer, oh comment résister
A cette douceur qui en retour l’aimait tant,
A qui il apprenait le bonheur d’être grand ?
Pourquoi t’éloignes-tu, pourquoi donc avoir peur ?
Je suis tonton Daniel, le mari de ta tante.
Tu veux me faire plaisir, tu n’es pas méchante.
En souvenir de nos étés, du bon vieux temps.
Tu pleures et fuis ? Tu veux me briser le cœur?
Si tu parles à ta mère, je dirai que tu mens.
Qui va-t-on croire? Un adulte ou un enfant ?
Cours ingrate, mon ogre attendra son heure.
Dans la clairière, au loin, j’entends d’autres agneaux.
Le lys
L’as-tu vu ce lys ? Il attend là sous ton nez.
Il éclaire les âmes prêtes à se transformer.
Sur le chemin du ciel, il livre ses fragrances
D’un arôme aussi pur que le soleil de transe
Dont les rayons nacrés rappellent la couleur
De son cœur refermé dans sa corolle en fleur.
Ce trident parfumé transmute toute chose
Et bientôt sa rosée caracole grandiose,
Dégringole tout droit vers vous et vers moi
Qui posez le nez sur sa sagesse, ses secrets
Tout enivrés de son éclat, sa pureté,
Un joyau de connaissance, une caresse, un émoi.
Douce transmutation quand ses effluves passent
De l’autre côté du monde, inversé, autre face.
La vision se trouble pour retrouver ci-nue
La magie des odeurs que l’on croyait perdues.
Le lys est le cadeau que les anges apportent
Une fois que les hommes ont traversé la porte
De la cité de l’Éden : l’amour universel.
D’autres l’avaient cherché comme on cherche un chemin
Quémandant leur route à des sourds ou des aveugles.
Revenir sur leurs pas alors que pas si loin,
dans leur for intérieur, il attendait bien seul.
Le lys, pistil de soufre, délicats pétales,
Plonge ses formes pointues au cœur du mal
Pour panser les blessures, guérir les souffrances,
Apaiser par sa beauté tous ceux dans l’errance.
Le prince je sais pas
Il était une fois dans le royaume de Kotanok, un prince que tout le monde trouvait adorable. Ses parents lui avaient donné pour prénom Glaven, ce qui veut dire « le bien aimé » dans la langue de ce royaume. Sa naissance avait été célébrée durant sept jours et sept nuits par tous les katanokais qui vivaient heureux, dirigés et protégés par le roi son père qui était un homme bon, bienveillant et généreux.
L’arrivée de cet enfant avait comblé de joie ses parents, d’autant plus comblés qu’ils avaient attendu bien longtemps sa venue. Les fées avaient accouru des quatre coins du royaume pour se pencher sur son berceau afin de lui offrir un don en cadeau. Ainsi, il serait beau comme le jour, sage comme une image, gentil avec quiconque, doué pour les arts et adroit comme un acrobate. Seule la fée de la décision manqua à l’appel. Était-elle malade ou en voyage ? En tous les cas, elle ne put donner au petit prince le don de faire des choix.
C’est pourquoi Glaven grandit en ayant toujours bien du mal à choisir entre ceci ou cela. Quand ses parents, le Roi et la Reine lui demandaient ce qu’il préfèrerait pour son anniversaire, un cheval en bois sculpté par le meilleur ébéniste du royaume ou un violon confectionné par le meilleur luthier, il répondait « Je sais pas ». Quand au moment du souper, on lui demandait de choisir entre les haricots verts ou les pommes de terre, entre le jus de pommes ou le jus de raisin, entre le fromage ou le dessert, il répondait « Je sais pas ». Quand ses professeurs lui demandaient de choisir entre l’équitation ou le fleuret, la géographie ou les mathématiques, il prenait immédiatement un air triste et répondait, les yeux pleins de larmes « Je sais pas ». C’est pourquoi Glaven acceptait tout ce qui lui était proposé, de peur de prendre la mauvaise décision et donc mangeait à la fois des haricots verts et des pommes de terre, buvait à la fois du jus de pommes et du jus de raisin, prenait à la fois du fromage et un dessert, pratiquait le fleuret à cheval et la géographie par le calcul des parallèles. Son indécision se répandit rapidement dans le royaume de Katanok et ses sujets lui donnèrent désormais pour surnom le prince-je-sais-pas.
Ses parents se disaient que cette indécision venait sans doute de sa trop grande gentillesse. En effet, choisir, c’est forcément dire non à quelque chose et le prince se refusait à faire de la peine à qui que ce soit. Ses parents se disaient également qu’en prenant de l’âge et de l’expérience, il apprendrait. On ne peut pas vivre heureux sans décider de quoi que ce soit. Le Roi et la reine en étaient pourtant fort inquiets car ma foi, il allait devenir Roi un jour et il serait bien obligé de prendre des décisions pour le bien du royaume, de la nature qui l’entoure, des animaux qui le peuplent et de tous ses sujets.
Un jour, Glaven devenu jeune-homme, fut convoqué par ses parents. Son père lui dit : « Mon fils, tu es grand à présent et il est temps pour toi de partir dans le royaume voisin pour trouver la femme de ton cœur, celle qui deviendra la future reine du royaume ». A ces mots, le prince se mit à défaillir. Son teint devint tout pâle. Sa mère lui dit : « Que t’arrive-t-il mon enfant ? N’es-tu pas heureux d’aller chercher l’amour ? ». Glaven lui rétorqua : « Oh, ma chère mère. Comment pourrais-je choisir celle qui fera mon bonheur quand je ne peux choisir entre monter le cheval noir ou le cheval blanc de notre écurie ? ».
- Ne t’inquiète pas mon fils. Tu prendras la bonne décision. Rien n’est plus simple. Il
suffit d’avoir confiance en toi et d’écouter ton cœur. Ton cœur saura te guider. C’est ainsi que cela s’est passé pour ton père et moi et cela fait trente ans que nous nous aimons d’un amour tendre. - Ta mère a raison, ajouta le Roi avec autorité. Écoute ton cœur et tu sauras faire le
meilleur choix pour toi. Prends le temps qu’il faut mais ne reviens au royaume que
quand tu auras pris une décision.
Le soir même, Glaven eut bien du mal à trouver le sommeil. Le lendemain matin, il alla dans son écurie où l’attendait son écuyer Kristull. Kristull était également en charge de tous les animaux du royaume. Il n’était plus très jeune mais connaissait bien le prince puisqu’il l’avait vu naître et lui avait transmis tout ce qu’il savait sur la nature et les animaux. Or, quand on connaît par cœur la nature et les animaux, on connaît l’essentiel de l’âme humaine. « Quelle monture voulez-vous choisir pour votre grand voyage, mon prince ? » lui demanda-t-il ?
- Oh, comme je suis ennuyé mon fidèle écuyer. Tous les chevaux sont dignes d’être
choisis puisque tu t’en occupes si bien. Ne sont-ils pas tous plus beaux et endurants
les uns que les autres ?
Kristull qui connaissait l’embarras de Glaven, lui répondit : « Si j’étais vous mon prince, je choisirais cette jument ». Et du doigt, il désigna au prince une magnifique jument grise.
- Ah oui ? Cela serait ton choix ?
- Sans aucun doute. Elle est douce, obéissante, rapide comme l’éclair, endurante et
possède un flair redoutable. Même aveugle, elle vous ramènerait chez vous. - Donc c’est elle que je dois choisir ?
- Si j’étais vous, cela serait mon choix en effet.
Glaven, qui avait beaucoup de respect et d’amitié pour son écuyer lui fit immédiatement confiance avant d’ajouter : « Tu m’as toujours tellement bien conseillé mon cher Kristull, que ferai-je sans toi, au loin, livré à mon seul jugement ? ».
Kristull s’empressa de le rassurer. « Tout ira pour le mieux ». C’était une phrase que Kristull disait souvent car il était de nature optimiste et avait du bon sens.
Glaven se mit donc en chemin avec la jument grise qui en effet était très rapide car au bout de peu de temps, il se retrouva aux portes du royaume voisin dont le roi avait deux filles à marier. Il fut immédiatement accueilli avec cloches et trompettes, banquet somptueux. Le roi l’installa en bout de table entre chacune de ses filles qui étaient aussi belles l’une que l’autre. L’une avait les cheveux blonds comme les blés, l’autre aussi noirs que l’ébène. Toutes deux avaient autant de conversation, si bien que Glaven passa le repas à écouter autant à sa droite qu’à sa gauche tout ce que les princesses avaient à lui raconter et il se retrouva avec un bon torticolis lorsqu’il s’allongea enfin dans le lit à baldaquin que ses hôtes lui avaient préparé avec la literie la plus agréable qui soit. Glaven était songeur et ennuyé.
Oh, comme ces deux princesses sont agréables et jolies. Laquelle choisir ?
Le lendemain, les deux princesses lui firent découvrir leur royaume. Elles traversèrent une forêt luxuriante où chaque plante sentait aussi bon que la rose. Tous les trois, ils s’arrêtèrent près d’une rivière. L’une des princesses, celle qui avait les cheveux blonds comme les blés, lui dit : « Voyez Glaven, cette rivière. Elle est particulière. Certains disent qu’elle possède des pouvoirs magiques. »
- Oui, continua sa sœur aux cheveux noirs comme l’ébène. Il paraît qu’elle est la
demeure d’une fée mais nous ne l’avons jamais rencontrée. Elle n’apparaît qu’aux
personnes désespérées. C’est pourquoi nous ne l’avons jamais vue. - Car nous ne sommes pas, heureusement pour nous, malheureuses.
- Comme vous avez de la chance de posséder une rivière enchantée. Nous n’avons pas cela dans mon royaume.
- Mais justement, ajouta la princesse blonde. C’est cela sa particularité. Notre
géographe n’a jamais su si elle appartenait à notre royaume ou bien au vôtre. Sans doute un peu des deux.
A ces mots, sa sœur demanda :
- Que voulez-vous faire à présent ? Continuer notre ballade ou bien rentrer au
château ?
Cette question embarrassa beaucoup Glaven qui ne put que répondre : « Je vous laisse décider ».
- Et bien rentrons au château. Il se fait tard et les nuages semblent annoncer la pluie. Nous pourrons continuer la visite du royaume un jour prochain.
Glaven, en si charmante compagnie, resta de longs jours et de longues semaines chez le roi du royaume voisin et continua à faire plus ample connaissance avec les deux princesses. Mais plus les jours passaient et moins il ne savait laquelle des deux gagnait sa préférence. L’une savait chanter comme un rossignol, ce qui enchante le cœur. L’autre peignait des tableaux comme il n’en avait jamais vus de si beaux. Il était bien ennuyé.
Un jour, le père des deux princesses le convoqua dans la salle du trône et avec un air
solennel lui dit : « Mon cher prince, mes filles vous trouvent toutes les deux charmant. Elles commencent à se jalouser l’une l’autre et se demandent à laquelle vous souhaitez demander sa main car le temps passe et il s’agirait de connaître à présent votre décision ».
Glaven ne put répondre que ces mots : « A vrai dire, votre Altesse, je trouve vos filles aussi charmantes l’une que l’autre. Je ne sais pas ».
- Très bien, rétorqua le roi. Prenez le temps qu’il faut. Vous êtes ici chez vous. Mais ne tardez pas trop tout de même car plus les jours passent et plus mes deux filles
s’attachent à vous. L’une des deux souffrira d’autant plus que votre décision sera
longue à venir.
Cette discussion plongea Glaven dans un profond désespoir. En effet, il ne pouvait les
épouser toutes les deux et il était pétrifié à l’idée de faire souffrir l’une ou l’autre. Quel
affreux dilemme. Il repensa aux conseils que lui avait prodigués sa mère, d’écouter son cœur mais il avait beau se retenir de respirer pour mieux écouter son cœur, il n’entendait rien. Tandis qu’il réfléchissait, il se retrouva malgré lui devant l’écurie du château où se reposait sa jument grise. Celle-ci, en le voyant, poussa un hennissement, comme pour lui dire :
« Viens, monte sur mon dos, cela va te changer les idées. »
En tout cas, c’est ainsi que Glaven interpréta ce hennissement. Alors, il la chevaucha et la laissa le guider au gré de ses envies. La jument galopa à tout rompre et prit la direction de la forêt que Glaven et les deux princesses avaient traversée. Puis, arrivés tout près de la rivière dite magique, elle s’arrêta, se cabra pour forcer le prince à poser pied à terre. Glaven se rappela que cette rivière était censée aider les personnes désespérées et c’est bien ce qu’il était à cet instant, un prince désespéré. Il s’assit près du lit de la rivière et plongea son regard triste dans un remous aux teintes argentées. Pleurant, il supplia la rivière de lui venir en aide. A cet instant, tandis qu’une larme de Glaven s’éloignait dans le courant, une femme d’une grande beauté émergea des flots. Glaven écarquilla les yeux. Par quelle magie cette femme venait-elle d’apparaître devant lui ? Qui était-elle ?
« Je suis la fée de la rivière. » lui dit-elle tout en s’asseyant à ses côtés. « Merci à toi beau jeune-homme. J’étais plongée dans un long sommeil. Seule une âme désespérée pouvait m’en sortir. Merci à toi. Je trouvais le temps bien long, seule, au fond des eaux. Comment puis-je t’aider puisque tel est mon destin, de porter secours à celui qui verse une larme dans le rivage ? »
A ces mots, Glaven lui raconta ses mésaventures, cette infortune qui l’empêchait de prendre une décision depuis que la fée de la décision avait déserté l’invitation de venir lui donner ce don au-dessus de son berceau.
La fée de la rivière immédiatement ajouta : « Mais je connais à vrai dire la fée de la décision. Elle est ma marraine. C’est une bien belle personne et je sais par les rumeurs des courants, qu’elle est occupée depuis longtemps à aider deux royaumes lointains qui se font la guerre pour une raison obscure et ne parviennent pas à trouver un accord de paix.
- Quelle étrange coïncidence ! répondit le prince qui à regarder de plus près, trouvait
la fée décidément charmante. - Alors, dis-moi, comment puis-je te venir en aide ?
Glaven lui demanda si elle avait le pouvoir de l’aider à choisir celle qui deviendrait son épouse car ses parents le pressaient en ce sens et il ne pourrait rentrer chez lui qu’avec l’élue de son cœur. Les deux princesses de ce royaume avaient toutes les qualités requises mais il ne parvenait pas à choisir.
La fée de la rivière, à ces mots, plongea ses mains dans l’eau, ce qui créa un grand tourbillon qui les transportèrent tous les deux dans le royaume lointain où se trouvait la fée de la décision. Celle-ci fut bien surprise de les trouver devant elle. Elle s’empressa de serrer sa filleule dans ses bras tout en l’exhortant à repartir très vite. La guerre continuait à ravager les plaines de deux royaumes voisins qui avaient toujours été amis. Cette guerre durait depuis si longtemps que les habitants des royaumes ennemis ne savaient plus pourquoi ils avaient commencé à se battre les uns contre les autres. La fée de la décision en était très triste car ses pouvoirs semblaient inefficaces face à ceux de la fée de l’infortune qui avait jeté un mauvais sort aux deux rois en question. Seul un miracle pourrait démêler la situation.
Aussitôt Glaven proposa son aide. « L’indécision, c’est mon affaire. J’ai dû apprendre l’art du du tact et du juste compromis. Je suis certain de pouvoir faire quelque chose. Mais pour cela, ma jument intrépide me serait fort à propos. » La fée de la rivière agita alors les méandres de sa robe vert-d ’eau et comme par magie, la jument du prince apparut à ses côtés.
« Vite ! s’enquit le prince, plein d’une fougue qui l’étonna lui-même. Allons trouver ces deux rois et trouvons le moyen de mettre fin à cette guerre insensée ! »
Et il se mit en chemin. Grâce à ce talent qu’il avait acquis, de ne fâcher personne, il réussit à faire s’asseoir autour d’une même table les deux rois ennemis. Que voulaient-ils ? Pourquoi se battre et détruire par le feu du canon leurs si jolies prairies ? Pourquoi plonger dans la désolation leurs peuples qui s’étaient toujours si bien entendus au point que nombre d’entre eux avaient créé des alliances par mariage dans l’un ou l’autre royaume ?
Les deux rois se regardèrent un long moment. Il est vrai qu’ils avaient eux-mêmes épousé la sœur de l’un et de l’autre et que leurs épouses se lamentaient depuis le début de cette guerre. La raison en était une montagne qui regorgeait d’une matière première qui permettait de créer la lumière et la chaleur dans les maisons. L’un et l’autre en revendiquait l’unique exploitation.
Le jeune prince se rendit compte que son indécision chronique lui avait appris la meilleure des leçons : la diplomatie. Alors, il proposa une solution. « Si cette montagne regorge de cette matière que vous dites essentielle, alors, elle est bien suffisante pour vos deux royaumes. Pourquoi ne décideriez-vous pas de vous en partager l’exploitation ? Les jours pairs de la semaine, pour l’un des royaumes et les jours impairs, pour l’autre.
Les deux rois réfléchirent un instant. En effet, cela semblait la solution à laquelle ils n’avaient jamais pensé. Comme ils se sentaient bêtes.
« Votre aveuglement, ajouta le prince, est à mettre sur le compte d’un mauvais sort que vous a jeté la fée de l’infortune. Semer la zizanie est sa raison d’être. »
Les deux rois se dirent alors en chœur qu’ils allaient conclure sur le champ un traité de paix, lever une armée commune pour débusquer la fée de l’infortune et l’emprisonner pour longtemps. Ils promirent à Glaven une reconnaissance éternelle et le sommèrent de festoyer avec eux pour trois jours et trois nuits.
Les deux premiers jours et premières nuits parurent fort longs à Glaven qui ressentait quelque chose d’étrange dans son cœur. Il n’avait en tête que l’image de la fée de la rivière. Celle-ci lui manquait. Pour la première fois, il éprouvait une envie qui lui semblait très claire. Il se rendit auprès des deux rois et leur annonça qu’il ne resterait pas davantage car il devait au plus vite terminer une mission de la plus haute importance. Il espérait qu’ils ne lui en tiendraient pas rigueur et ne verraient pas cela comme un affront. Contre toute attente, ceux-ci l’empressèrent de partir. Ils lui étaient redevables et non le contraire. Il serait le bienvenu quand il le voudrait.
Glaven, soulagé, surmonta sa jument et l’élança vers l’endroit où il avait laissé la fée de la décision et la fée de la rivière, sa filleule. Quand il arriva enfin, il eut la déconvenue de constater que la fée de la décision était seule.
« Oh, cher prince, s’exclama-t-elle, tu as réussi ta mission ! Par les deux royaumes, on ne parle que de ton exploit. Pourquoi sembles-tu si triste ? Tu devrais au contraire, être rempli de joie.
- C’est que, lui avoua le prince, je commence à entendre mon cœur.
- Ah oui ? lui répondit la fée. Et que te dit-il ?
- Ma foi, pour la première fois, il bat d’un battement clair.
- Et pour quoi ou pour qui bat-il enfin si clairement?
- Pour votre filleule. Je l’ai quittée tantôt et tout de suite, j’ai ressenti quelque chose
que je n’avais jamais ressenti jusqu’alors. Elle me manquait déjà. - N’en soyez pas alarmé. C’est ce que ressent un cœur épris d’amour.
- Je serais donc amoureux ?
- Je crois que oui cher prince.
- Vraiment ? C’est donc cela dont me parlaient mes parents ?
- Pourquoi ne vas-tu donc pas la retrouver ? Elle est retournée dans sa rivière qu’elle
ne peut quitter qu’un court instant. - Mais elle n’apparaît qu’aux âmes désespérées…
- N’es-tu plus désespéré ?
- Oh si, je le suis, à l’idée de ne plus jamais la revoir.
- Alors, va, jeune prince, galope, galope.
Aussitôt dit, aussitôt fait grâce à la rapidité et l’endurance de la jument grise. Quelle bonne décision de s’en être remis à l’avis de son écuyer. Cette jument était la monture parfaite.
Lorsqu’il arriva tout près de la rivière, Glaven soupira. Il avait beau appeler la fée, celle-ci n’apparaissait pas. La nuit tomba, le jour se leva. Puis d’autres nuits, d’autres jours jusqu’à ce que totalement affamé et désespéré, Glaven en fit tomber une larme dans le courant de la rivière. A cet instant, la fée apparut. « Quel plaisir de te revoir mon prince. Que puis-je pour ton bonheur ? » Glaven ne se fit pas prier longtemps. Il se mit à genoux devant elle et lui demanda si elle accepterait de devenir sa promise. Il n’avait plus de doute, plus d’indécision à présent. Il savait qu’elle était l’élue de son cœur. Il l’avait attendue si longtemps.
La fée prit un air solennel avant de se jeter dans ses bras et lui répondre qu’elle aussi
l’attendait depuis toujours car seul un véritable baiser d’amour pouvait la délivrer de la rivière dont elle était prisonnière, sort que lui avait jeté la fée de l’infortune quand elle était petite.
Tous les deux joignirent leurs mains. Glaven posa un doux baiser sur les lèvres de la fée qui tout de suite se sentit délivrée.
Leurs noces furent célébrées pendant sept jours et sept nuits dans tout le royaume de Katanok, comme le fut la naissance de Glaven. Les rois, reines, princes, princesses, sujets des royaumes voisins et lointains se pressèrent à cet événement, y compris les deux princesses que Glaven avaient côtoyées et qui se réjouissaient de ce mariage car elles avaient elles aussi trouvé l’amour dans la personne de deux beaux marquis. La fée de la décision, qu’une guerre ne retenait plus désormais, fit la promesse d’être la première fée à accourir lorsqu’un enfant naîtrait de cette union. La fée de l’infortune, quant à elle, se lamentait du fin fonds de la tour glaciale où elle avait été jetée en prison. Gardée par cent preux chevaliers, elle ne ferait plus de mal à quiconque.
Glaven et la fée de la rivière dont le prénom était Laurianne furent très heureux pendant très longtemps. Et Glaven, depuis ses exploits de fin diplomate, ne fut plus jamais surnommé le prince je-sais-pas.
Quand dire oui, quand dire non ?
Prendre des décisions n’est pas chose facile.
Soupeser le pour et le contre s’avère un grand talent
Pour qui veut être juste et bienveillant.
Prends ton temps, réfléchis, ne te fais pas de bile.
A l’écoute de son cœur on trouve des solutions
Et le bon choix intervient toujours au bon moment.
Photos
et sculptures



xyz
Vous souhaitez prendre rendez-vous ?